1951, l’usine de Lacq, les débuts
La première partie de l’exposition revient sur cette aventure exceptionnelle et unique dans l’histoire industrielle européenne.
Découvrez sur des maquettes les différentes transformations du gaz, comprenez son extraction, sa transformation, le circuit de sa distribution au niveau européen.
L’usine de Lacq
Décembre 1951, le gaz jaillit à Lacq 3. La Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine (SNPA) vient de découvrir « Lacq-Profond » : un destin de « multinationale » s’ouvre à elle (en 1976, elle deviendra Elf Aquitaine pour être finalement absorbée par le groupe Total en 2000).
Le gaz de Lacq possède des propriétés physico-chimiques extrêmes : une forte pression, une forte température, une forte teneur en hydrogène sulfuré et en gaz carbonique.
Mise en exploitation au mois d’avril 1957, la capacité de traitement de l’usine était alors d’un million de mètres cubes de gaz brut par jour. Elle a augmenté par étapes, par l’addition de nouvelles installations, pour pouvoir traiter jusqu’à 33 millions de m3 par jour en 1975.
Depuis 1982, la charge de l’usine diminue par paliers au fil des années jusqu’en 2013.
La distribution du gaz commercial
Du fait des nouvelles réserves disponibles de gaz naturel dans le Sud Ouest, la Société Nationale de Gaz du Sud Ouest (SNGSO) se voit confier les missions de transporter et commercialiser le gaz naturel dans 14 départements du sud-ouest de la France soit plus de 800 km de canalisations.
Le réseau se développe très rapidement de l’Atlantique à la Méditerranée: 3000 kilomètres dans les années 80 et 4200 kilomètres aujourd’hui à travers 400 points de livraison.
La production d’aluminium
Avec la création de la centrale électrique d’Artix, EDF brûle le gaz naturel de Lacq pour en faire de la vapeur qui alimente et fait tourner 3 générateurs de 125 mégawatts chacun. Les deux tiers du courant électrique produit alimentent l’usine Péchiney de Noguères, qui transforme la bauxite en aluminium de première fusion.
Cette centrale est installée au bord du Gave et nécessitera la construction d’une série d’ouvrages hydrauliques, dont le barrage sur le Gave.
Inaugurée en 1960, c’est l’usine d’aluminium la plus moderne existant à l’heure de sa mise en service. Elle sera longtemps la vitrine de la technologie des cuves Soderberg à 100 000 ampères. En 1980 sa production était de 90.00 tonnes/an.
La chimie des plastiques
Pour développer l’utilisation des produits extraits du gaz de Lacq, la Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine (SNPA) construit à Mont, en 1962, un site consacré à la production des matières plastiques. Deux lignes de polyéthylène haute pression (Pehp) rapidement adaptées pour la production de copolymères éthylène acétate de vinyle (EVA) démarrent en 1963. Ces unités s’arrêteront définitivement en 2005.
La fabrication de Lactame 12 est inaugurée en 1970, cette production augmentera au fil des ans pour atteindre une capacité de 24000 tonnes / an.
En 1998, Arkema s’engage résolument dans la recherche appliquée autour des nanomatériaux. Avec le démarrage du pilote Nanostrength Arkema passe à leur fabrication à l’échelle industrielle et s’impose comme un acteur mondial majeur dans le domaine des nanomatériaux.
Le site de Pardies
Jusqu’à la fin 2009, le site était occupé par trois unités industrielles (YARA, AIR LIQUIDE, CELANESE) fortement imbriquées et interconnectées grâce à un réseau de pipelines qui leur permettait des échanges de matières premières. Ces trois usines utilisaient de grandes quantités de gaz naturel, tant comme source d’énergie que de matières premières.



2013, fin de l’exploitation du gaz commercial
L’exploitation du gisement de Lacq s’achève en 2013, mais depuis déjà plusieurs années, les collectivités publiques, les syndicats et tous les acteurs économiques du bassin industriel oeuvrent pour la pérennité de ce site exceptionnel et unique en France.
- Quels sont les atouts et les handicaps, de ce site ?
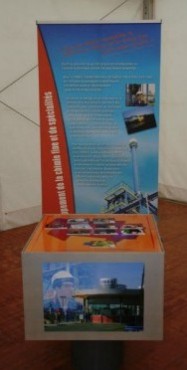
- Quelles sont les transformations et les innovations mises en oeuvre ?
- Quelles orientations donner à une politique de développement industriel ?
Voici quelques questions auxquelles tente de répondre cette partie de l’exposition.
Un territoire bien adapté au développement de l’industrie chimique
Fort de cinquante années d’exploitation du gaz, le bassin industriel de Lacq dispose de nombreux atouts :
- Des équipements industriels chimiques diversifiés.
- Des infrastructures logistiques (réseau ferré, électricité, gazoducs, transport de fluides divers).
- Des dispositifs de sécurité.
- Des périmètres de protection.
- Des capacités de traitement des effluents et des déchets.
- Des équipes de recherches innovantes.
- Une culture industrielle et de gestion du risque partagées.
Développement de la chimie fine et de spécialités
La SOBEGI (Société Béarnaise de Gestion Industrielle) gère depuis 1975 une plateforme qui accueille des industriels de la chimie fine et de spécialités.
Ceux-ci bénéficient d’une large gamme de prestations mutualisées allant de la fourniture d’utilités (électricité, vapeur, azote, eau de refroidissement, air comprimé…) au traitement des effluents liquides solides et gazeux en passant par la maintenance et la sécurité.
Environnement et chimie verte, les voies d’avenir d’une industrie durable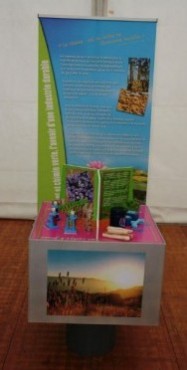
Les végétaux peuvent remplacer le pétrole dans la majorité des process de l’industrie chimique. Ils ont l’avantage d’être renouvelables, biodégradables et leur production ne contribue pas ou peu à l’émission de gaz à effet de serre. Souvent encore expérimentale, la chimie verte concerne les domaines des énergies, des matériaux ou encore de la chimie fine (médicaments, produits de beauté…) ou encore le secteur alimentaire.
Dans le domaine de l’énergie, ABENGOA (avec son usine de fabrication d’éthanol à partir de graines de maïs), ou BIOLACQ ENERGIES (qui produit de la vapeur à partir de la biomasse agricole et de déchets forestiers), ouvrent de nouvelles relations entre agriculture et industrie, et de nouvelles perspectives pour le site de Lacq.
L’implantation de PHYTOCOS sur la plateforme SOBEGI ou celle d’ HOLIS TECHNOLOGIE ouvrent également des perspectives nouvelles en matière de synthèse organique et de distillation.
Chemstart’up : Innover pour aller de l’avant
Chemstart’up accueille des jeunes entreprises au sein de modules pré-équipés, spécialement conçus pour l’activité chimique.
L’objectif est qu’elles puissent se consacrer totalement au développement de leur activité en facilitant la résolution de leurs contraintes et en réduisant leurs frais de fonctionnement.
La proximité du Groupement de Recherche de Lacq, de l’Université de Pau et les Pays de l’Adour et des centres universitaires de Bordeaux et Toulouse garantit un environnement scientifique de qualité.
La filière énergétique : vers de nouveaux potentiels
La question énergétique est depuis toujours au coeur de l’activité industrielle de la zone de Lacq.
Le projet porté par la SNET de construction d’une centrale électrique combiné-gaz d’une capacité de 800 Mégawatts, ouvre des perspectives nouvelles et renoue avec les origines. On enregistre des investissements favorables aux nouvelles énergies :
- Le groupe espagnol ABENGOA, spécialiste des biocarburants a construit la 1ère usine française de bioéthanol à base de maïs sur le bassin de Lacq.
- ELYO investit dans la cogénération biomasse à Lacq utilisant des déchets agricoles ou forestiers. Baptisée Biolacq Energies, cette unité produit de l’électricité et la vapeur, une énergie écologique.
Chimie et nouveaux matériaux
La SNPA a souhaité, dès ses origines, développer la chimie des plastiques. C’est la vocation de la plateforme industrielle de Mont. Plus qu’un site de grande production, l’usine de Mont a souvent été un site d’expérimentation, après le polystyrène et le polyéthylène, elle produit maintenant des polymères techniques (lactame 12).
Le groupe chimique ARKEMA construit une usine de nanotubes de carbone (NTC) à Mont. Celle-ci produira 400 tonnes annuelles et devrait être opérationnelle début 2011.
Depuis 1985, la SOFICAR – Société des Fibres de Carbone (groupe japonais Toray) produit des fibres de carbone. L’installation d’une 5e ligne de production dans son usine d’Abidos permet de répondre à l’augmentation de la demande, notamment de la part de l’aéronautique, en portant la capacité de production de 3 400 à 5 200 tonnes par an.
Une pépinière de savoir-faire
L’industrie chimique génère à sa périphérie une diversité d’activités dans le domaine de l’isolation, de la chaudronnerie, de la peinture industrielle, des systèmes mécaniques et électromécaniques, autant d’atouts pour développer et diversifier un réseau de moyennes et petites entreprises performantes.
Créée en 1995 l’Association « LACQ PLUS » compte aujourd’hui près d’une centaine de membres adhérents d’activités diverses : Institutionnels, Industriels, PME/PMI. Sa vocation est de favoriser les échanges entre les intervenants du bassin dans le but de promouvoir l’emploi. Par la mise en oeuvre de ses actions, elle contribue à dynamiser les forces locales pour assurer l’avenir du territoire.



